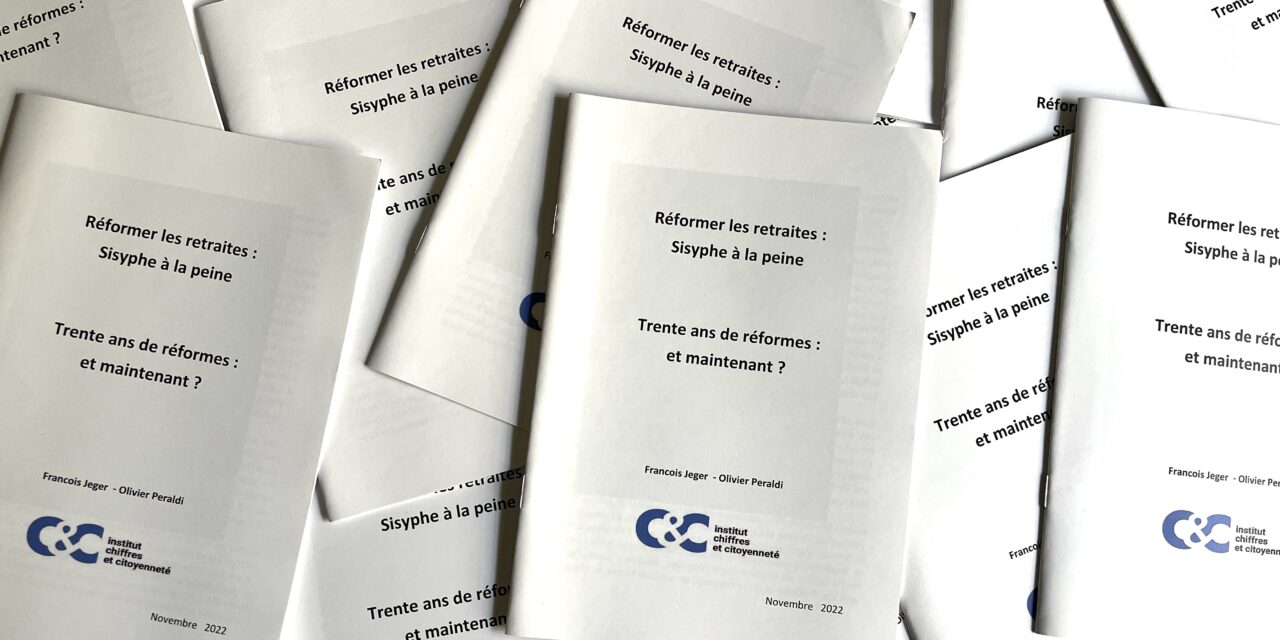Depuis plus de trente ans, la France n’en finit pas avec la question du poids des retraites. Pour 2023, Sisyphe remet ça. Et la pente est rude. Retour sur un boulet français.
La réforme des retraites, ce boulet si français des gouvernements depuis trente ans… Mère des réformes pour certains, aucun autre sujet n’aura autant suscité dans la durée autant de polémiques. Michel Rocard, alors Premier Ministre avait donc raison, déclarant dès 1990 qu’il y avait-là de quoi faire « sauter plusieurs gouvernements ». C’était il y a plus de trente ans : autant dire que le problème était plus prévisible que tout autre. C’est la loi d’airain de la démographie : les babys boomers qui avaient financé les pensions confortables de leurs parents sont arrivés eux-mêmes à la retraite à partir des années 2005 avec moins d’enfants pour la financer, ceux-ci devenus adultes et… actifs. S’il est un seul chiffre à retenir : de 2,7 actifs pour un retraité en 1980, il n’y en plus que 1,7 aujourd’hui et ce sera 1,4 en 2040…
Nul ne peut ignorer aujourd’hui cette équation. Les autres pays européens, confrontés aux mêmes réalités, ont commencé des réformes bien avant la France. Ce qui fut un sujet de consensus en Espagne[1] ou de compromis en Allemagne[2] est, en France, un exhausteur d’oppositions politiques. Encore récemment, en pleine campagne présidentielle, le programme de la retraite à 65 ans suscita immédiatement une contre-proposition pour le retour à 60 ans. Jeu de Sumo ?
D’un côté, la froideur des chiffres sans appel – le déficit est certain – comme l’a rappelé encore récemment la Cour des Comptes, de l’autre, l’anxiété face à ce qui est perçu comme le recul d’un acquis social. Tous les protagonistes prétendent, la conscience tranquille, agir pour leurs enfants : les uns affirmant que la pérennité du système passe par sa soutenabilité financière, les autres qu’il faut protéger le modèle social en taxant les « riches » et les superprofits des entreprises… La France, réputée égalitariste, a pourtant refusé en 2019 l’unification des quarante-deux régimes de retraite. Les futurs perdants de cet alignement ont même réussi à entrainer dans leurs manifestations ceux qui auraient été gagnants (petites retraites, femmes).
Il y a donc le fond, le déséquilibre financier, et la forme : « la méthode pour réformer ». Ici, l’art politique relève moins de la conception que de l’exécution. L’expérience des réformes depuis trente ans mérite d’être examinée : pourquoi certaines réformes furent adoptées (1993, 2002, 2010), et d’autres échouèrent ou n’eurent pas les effets escomptés (1995, 2004, 2019) ?
Si le contexte économique et social joue, le succès ou l’échec tient surtout à l’interaction entre la communication du gouvernement et l’inconscient collectif français, corseté de symboles et de tabous. L’âge du départ à la retraite focalise toutes les crispations. Ce n’est pourtant qu’un paramètre de l’équilibre. Dans ce débat, la passion domine la raison. Si les partenaires sociaux en connaissent les subtilités (durée de cotisation, dispositif de départ anticipé pour pénibilité ou carrière longue, minimum contributif), le public ne retiendra que la crispation du débat sur l’âge de départ. Les raisons de réformer des retraites sont d’ordre financier : pour le public, dans sa grande masse, c’est donc une affaire de chiffres et de technocrates. Deux points peu séduisants tant ils rebutent dans leur supposé complexité.
Concernant les prévisions à 20 ou 30 ans, ces chiffres s’appuient sur des hypothèses économiques fragiles. D’un rapport à l’autre, toutes les hypothèses de croissance ou de chômage ont été démenties. Cette fragilité prête à toutes les interprétations, des plus documentées aux moins responsables. Pourtant, le Conseil d’orientation des retraites (COR) fut créé en 2001 pour établir un diagnostic partagé sur la situation financière de l’ensemble des régimes. Las, l’accumulation de rapports souvent contradictoires et de simulations diverses, a rendu l’institution inaudible : chacun interprète, y compris en son sein, les estimations, évaluations et projections comme il l’entend en se souciant plus d’impact politique à court terme que d’honnêteté intellectuelle et de rigueur scientifique. Parce qu’un syndicat a demandé une simulation du retour à 60 ans de l’âge de départ à la retraite – donc un plus grand déficit – un homme politique n’hésitera pas à affirmer que le COR avait jugé possible ce retour…
Discours, crédibilité et scenarii
Face à cette avalanche de chiffres, le citoyen est perdu. A quel discours peut-il croire ? Les institutions publiques, de préparation à la décision (COR, CESE, France Stratégie, etc.), et en responsabilité de cette décision à prendre (gouvernement, parlement) sont disqualifiés aux yeux et aux oreilles d’un citoyen devenu au mieux sceptique, au pire aveugle et sourd. Il préfèrera les affirmations d’« experts » qui partagent sa propre opinion. Le réflexe est plus ou moins conscient, porté par l’émotion, plus fort que la raison ; il est humain. Les sociologues en soulignent les causes et les effets. Ils qualifient le phénomène de « biais cognitif », consistant à développer une stratégie de contournement des réalités perçues comme trop complexes à saisir ou par trop inquiétantes. Résultat : on n’écoute que ce qui renforce nos convictions. Un syndicaliste présentant les chiffres officiels s’est entendu dire : « on vous croit car vous êtes représentant de notre syndicat mais on ne croit pas aux chiffres du gouvernement » : c’étaient pourtant les mêmes !
Dès lors, est-il encore possible de renouveler la crédibilité des organismes officiels (COR, Commission de suivi des retraites – CSR) ? En 2003, pour préparer la réforme Fillon, le gouvernement a demandé au COR de faire un petit livret présentant les enjeux de la réforme. Ce document sera tiré en 50 000 exemplaires et distribué dans les préfectures pour alimenter des débats publics. 45 000 d’exemplaires seront jetés au pilon ! C’est dire le manque d’intérêt et de confiance envers toutes informations officielles. Pourtant, tous les organismes publics ne peuvent être soupçonnés de diffuser la propagande gouvernementale. L’indépendance de l’Insee est connue de tous et ses chiffres rarement mis en cause. Les rapports de la Cour des Comptes également. Moins connue que le COR, la CSR est composée d’experts indépendants et d’un jury citoyen tiré au sort.
Cette commission, créée en 2014, émet des avis auprès du gouvernement, portant sur les moyens d’assurer la pérennité et l’équité du système de retraite. Dans son dernier avis en date[3], la commission souligne la nécessité des réformes pour espérer l’équilibre à terme du financement. L’avis précise plusieurs scenarii possibles mais aucun d’indolore pour l’ensemble de la population.
Ainsi, le premier scénario, qui propose l’augmentation des cotisations des actifs (et/ou des impôts des contribuables), ferait peser les efforts sur les salariés et/ou les ménages à un moment où la question du pouvoir d’achat est plus que jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, inscrite dans l’agenda social. De plus, il est légitime de poser la question : ces recettes ne seraient-elles pas mieux affectées à la santé, à l’enseignement, la Justice, la Recherche publique ? tout services publics dont l’immense majorité des Français constate la dégradation. Autrement dit, les Français sont-ils prêts à travailler plus longtemps pour faire face à la crise de l’hôpital, d’origine financière, de l’école ou de la Justice ? C’est une question d’équité entre les générations. Les seniors d’aujourd’hui ont vu leurs parents accéder à la retraite à 60 ans, voire plus tôt, et souhaiteraient faire de même : le monde a pourtant changé en un sens défavorable aux jeunes. Peut-on ajouter au dérèglement climatique le poids d’une dette incontrôlable ?
Un deuxième scénario serait de baisser le montant des pensions. C’est ce qui a été fait : depuis trente ans la pension moyenne a baissé de 10 % en comparaison du salaire moyen. Pourtant, la France est encore le pays de l’OCDE où les retraites sont les plus élevées. Cette diminution serait insupportable pour les petites retraites affectées déjà par l’inflation. En 2022, la revalorisation des pensions ne suit pas l’inflation (5,1 % contre 6,2 %). Les experts du CSR et le jury citoyen recommandent plutôt des mesures visant à retarder le passage à la retraite.
Les troisième et quatrième scenarii consisteraient respectivement à reculer l’âge légal de départ à la retraite et à augmenter la durée de cotisation. Les enjeux politiques de chacune de ces mesures sont connus : repousser l’âge légal à 65 ans pose la question de la pénibilité de certains métiers. Malgré les avancées de la loi de 2014, la traiter de manière équitable et efficace pose de telles difficultés pratiques qu’aucun autre pays n’a mis en place un tel système. De fait, c’est le dispositif « carrières longues » qui a pris en charge la fin de carrière des métiers manuels. Il faudra portant traiter la question des salariés qui se sont « usés » prématurément : c’est une question de justice sociale. L’idée de modifier la sémantique en parlant d’ « usure au travail » plutôt que de « pénibilité du travail » suffira-t-elle à changer la donne dans l’opinion publique ? Pas sûr.
Augmenter la durée de cotisation pénaliserait les départs tardifs dans la vie active (pour études ou chômage) ainsi que les femmes ou ceux qui ont eu des carrières hachées. Les opposants au recul de l’âge de la retraite font valoir, à juste titre, les difficultés d’emploi des séniors.
Retraite et emploi des séniors
La France est sur ce point le mauvais élève des pays européens. Le monde du travail, entreprises mais aussi administrations, considèrent trop souvent un salarié de plus de 55 ans, voire 50 ans, comme une charge. Malgré l’amélioration du nombre de séniors encore en emploi passé 55 ans, à la suite de la réforme de 2010, le taux d’emploi des séniors reste trop faible en France. De fait, les études récentes montrent le lien étroit entre âge légal de la retraite et taux d’emploi des séniors. D’un côté, un faible taux d’emploi de ces derniers est un obstacle politique au recul de l’âge légal. Inversement, le désintérêt des employeurs envers leurs salariés tient moins à leur âge absolu que du temps qui leur reste à travailler avant la retraite : c’est l’effet « horizon » qui veut que plus approche l’échéance plus les salariés se désinvestiraient. Pour preuve, le recul à 62 ans a eu pour effet d’augmenter le taux d’emploi des 50-59 ans de 55 % en 2010 à 75 % en 2022.
C’est par une combinaison subtile de ces différents paramètres (cotisations, montant des pensions, âge légal, durée de cotisation) que la martingale est à trouver. Mais il serait imprudent d’ignorer l’opinion publique attachée à des symboles (âge légal de départ) et des tabous. Le recul à 65 ans de l’âge légal est la mesure la plus efficace financièrement à court terme. C’est aussi celle dont on peut attendre l’opposition la plus forte. Les partis politiques les plus démagogiques l’ont bien compris en proposant un retour à 60 ans.
Le déni du problème du financement des retraites a été accru par la politique du « quoi qu’il en coûte » lors de la crise de la Covid. « Puisqu’on a su trouver des centaines de milliards pour gérer la crise, pourquoi pas des dizaines pour la retraite ? » entend-on régulièrement ici où là… Et les propositions ne manquent pas : faire tourner la planche à billet, taxer les super profits ou rétablir l’ISF…
Trente ans à petits pas
La France choisit en 1945 un système de retraite par répartition : les cotisations des actifs paient les pensions des retraités. Plus les actifs sont nombreux, meilleures peuvent être les pensions. Surtout si les retraités sont peu nombreux au regard du nombre de cotisants. Tel fut le cas dans les années 1970 et 1980 où les générations nées entre les deux guerres étaient peu nombreuses tandis que les générations du baby-boom travaillaient. Cette conjoncture favorable permis d’améliorer les retraites bien au-delà de ce qui était prévu lors de la création de la branche « vieillesse » de la Sécurité sociale en 1945 : il s’agissait alors simplement de « protéger de la pauvreté » les vieux travailleurs réduit à l’inactivité du fait de leur avancée en âge ; et non pas de financer plus d’un quart de siècle de vie sans travail après la vie professionnelle.
La création de caisses de retraite complémentaires ARCCO puis AGIRC ont visé à limiter la perte de revenus lors de la cessation d’activité. Les syndicats se sont focalisés sur l’augmentation des taux de remplacement[4]. Aujourd’hui, le niveau de vie moyen des retraités dépasse la moyenne de celui des actifs.
Les salariés acceptent de cotiser pour les retraites, pensant acquérir des droits pour la pension de leurs vieux jours. Mais cela ne fonctionne que sur le principe de la solidarité entre générations, qui implique d’être certain que les futures générations cotiseront plus tard pour eux.
En 1991, le livre blanc de Michel Rocard alerte sur le futur danger démographique. Les générations du baby-boom arriveront à la retraite au début du XXIe siècle et le nombre de cotisants par retraité va baisser…
Eté 1993 : la méthode catimini
En 1993, la crise économique fait chuter les cotisations : le déficit de la CNAV est de 40 milliards de francs : il faut agir. A l’été, Edouard Balladur, juste nommé Premier Ministre, profite de la période estivale pour promulguer une loi en juillet suivi d’un décret en août dont les syndicats ne prennent pas immédiatement toute la mesure. Il est certes difficile de mobiliser les adhérents en plein farniente estival. Le décret prévoit d’allonger de 37,5 ans à 40 ans la durée de cotisation. Cela concerne peu les quinquagénaires qui ont souvent commencé à travailler avant vingt ans. Il prévoit aussi de calculer la retraite sur les vingt-cinq dernières années et non plus les dix, ce qui défavorise surtout les cadres à carrière ascendante. Enfin, et de manière subtile, les salaires cotisés sont réévalués sur l’indice des prix et non sur celui des salaires, ce qui fera chuter le taux de remplacement. La CNAV est ainsi sauvée. Cette réforme dont l’application est étalée sur dix ans ne suscite pas de grandes manifestations. Ce sera pourtant celle dont les effets, à terme, auront été les plus importants : la pension moyenne aura baissé de 10 %.
La méthode utilisée est intéressante à plusieurs titres. a) Le gouvernement s’appuie sur la légitimité d’une élection récente. b) Il profite de la période des vacances où les salariés sont moins mobilisables. c) C’est une réforme paramétrique qui ne concerne ni les fonctionnaires ni les régimes spéciaux, les plus enclins à faire grève. d) La conjugaison de plusieurs paramètres brouille l’évaluation de son impact sur chaque situation. e) Elle s’étale sur dix ans : les salariés proches de la retraite seront peu pénalisés. Enfin f), elle ne touche pas à l’âge symbolique de 60 ans considéré comme un acquis social.
Pourtant les autres pays européens comparables sont confrontés au même défi démographique et ont déjà commencé leurs propres réformes. L’âge de la retraite y est déjà de 65 ans…
1995 : une histoire de bottes… et l’échec
Légitimé aussi par l’élection présidentielle récente, le gouvernement Juppé s’alarme de la dérive des comptes de la sécurité sociale. Celle-ci est depuis la libération à la main des partenaires sociaux. Ces derniers s’inquiètent peu de la dette, puisque l’Etat s’en porte garant. Pourtant, une partie croissante des recettes de la Sécu ne relève plus des cotisations sur le travail, mais d’un impôt pesant sur tous, actifs et non actifs : la Contribution sociale généralisée (CSG).
Il est donc légitime que la représentation nationale contrôle son budget. Chaque année désormais, le Parlement votera à l’automne un Projet de loi du financement de la sécurité sociale (PLFSS). De plus les directeurs des quatre branches de la Sécu seront désormais nommés par le gouvernement.
Le premier ministre prend le taureau par les cornes pour contenir les dépenses publiques. Le 15 novembre 1995, il annonce l’intention de repousser pour les fonctionnaires et les régimes spéciaux à 40 ans, comme dans le privé, le nombre d’annuités nécessaires pour atteindre le taux plein. D’autres mesures d’économies pour la branche maladie sont aussi prévue : elles toucheront tout le monde.
La réaction des syndicats ne se fait pas attendre : la SNCF et la RATP entrent en grève totale pour trois semaines. Ce sera la plus longue de l’histoire récente. Les rails commencent à rouiller… Les plupart des Parisiens se déplace à vélo, à pied… et dans le froid. Ceux qui prennent leur voiture sont bloqués dans de gigantesques embouteillages. Les uns doivent partir à 6 heures du matin, les autres rentrer à 21 heures. Pourtant la majorité des Français soutient le mouvement. Ils sentent pour la première fois que la protection sociale peut être remise en cause. Le mouvement s’étend aux fonctionnaires puis aux salariés. Le 12 décembre on comptera 2 millions de grévistes.[5] Après avoir déclaré, par la voix du Premier Ministre, qu’il restera « droit dans ses bottes » le gouvernement recule puis abandonne la réforme. Cet échec marquera fortement les gouvernements suivants. Le sujet « retraites » est devenu explosif.
2002 : temporiser…
Le sort du projet de réforme 1995 pousse à la prudence. Dans un climat pré-électoral, on ne veut pas s’aliéner les électeurs. A court terme, il n’y a pas péril car la croissance est revenue. Pour déminer préventivement, un Conseil d’orientation des retraites (COR) est créé . Il est censé établir un diagnostic partagé avec les organisations syndicales et patronales. Considérant que le sujet relève des prérogatives des seuls partenaires sociaux, le Medef refuse dans un premier temps d’y participer ; il y reviendra plus tard. Les rapports du COR seront utilisés pour les réformes de 2003 et 2010.
Par la suite, le COR perdra sa crédibilité par des rapports trop nombreux aux conclusions remises en cause par le rapport suivant. Dans ce brouhaha de chiffres, chaque partie retiendra ceux justifiant sa position.
Il est aussi créé un Fonds de réserve des retraites (FRR), en vue de faire face à l’arrivée des générations nombreuses dans les années 2020 à 2040. Certains craignent que ce fonds ne soit pas protégé sur le moyen terme, encore moins sur le long terme.
Avec de nombreux déficits par ailleurs, l’Etat sera tenté de le siphonner pour combler d’autres trous de la Sécurité sociale. C’est effectivement ce qui s’est passé : il est maintenant utilisé[6] pour soutenir les remboursements des emprunts, confiés à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) qui porte la dette de la Sécu. Prévu d’être doté de 150 milliards d’euros en 2020, il n’en a aujourd’hui que 36.
La réforme Fillon 2003 : l’égalité oui, mais… pas pour tous
Les travaux du COR sont utilisés par le gouvernement Raffarin pour préparer une loi en 2003. François Fillon en assumera la charge. Premier objectif : aligner la durée de cotisation des fonctionnaires (37,5 ans) sur celle des salariés du privé (40 ans). Résultat : 1,5 million de manifestants dans la rue… En coulisse, le gouvernement négocie avec le patron de la CFDT, François Chérèque, qui obtient en contrepartie le dispositif « carrières longues ». Cette compromission lui fut reprochée : la CFDT, perdra alors nombre d’adhérents dans le secteur public. L’épisode laissera des traces durables jusqu’à entraîner la centrale syndicale à faire volte-face en 2019 sur sa volonté première d’instauration d’un régime unique de retraite en s’opposant à la réforme vers un dispositif unique de retraite à points.
L’introduction et l’instauration de la notion de pénibilité fut considérée comme une victoire syndicale. La loi Fillon donnera trois ans aux partenaires sociaux pour se mettre d’accord sur les critères de pénibilité. Trois ans perdus puisqu’aucun accord ne sera trouvé. Le Medef campe sur la position : ne tenir compte que des effets avérés sur la santé, ce qui existait déjà dans le dispositif « retraite pour inaptitude ». Les syndicats veulent, tout au contraire, intégrer dans les critères de pénibilités les actes entraînant un impact sur l’espérance de vie sans incapacité sur le modèle de l’exposition à l’amiante sans préoccupation que ces impacts soient clairement la conséquence de l’activité professionnelle. Les deux points de vue restent inconciliables. Il faudra attendre la loi Touraine, en 2014, pour que soient précisés par décret des critères de pénibilité.
Sarkozy 2010 : passage à 62 ans
La crise de 2008 a fortement dégradé les comptes sociaux : il faut agir. Même si ce n’était pas inscrit au programme du quinquennat, les prévisionnistes de la CNAV et du ministère s’inquiètent et simulent l’effet du recul de l’âge légal. Leurs calculs conduisent à ce que le conseiller technique du Ministère[7] de la Solidarité propose un départ à 63 ans.
Cet âge de départ est celui qui assurera l’équilibre financier pour vingt ans. Le conseiller social de l’Elysée active ses réseaux syndicaux : repousser de trois ans est jugé trop « violent ». La loi retiendra donc l’âge de 62 ans. Les calculs technocratiques seront ignorés : c’est le « flair » très subjectif de la situation politique. Nul ne peut savoir à quelle résistance se serait affronté un recul à 63 ans. L’ampleur des manifestations de l’automne 2010 montre la tension sociale sur le sujet avec 2 millions de manifestants dans la rue. Un record historique. Pourtant, le gouvernement tient bon et la loi passe.
2014 : la retraite pour… pénibilité
Les perspectives des comptes sociaux à terme ne s’améliorent pas. Plutôt que toucher à l’âge de la retraite, c’est la durée de cotisation qui augmentera d’un trimestre tous les trois ans. Premier avantage : cela touchera plus les jeunes générations a priori moins sensibles au sujet « retraite ». Second avantage, l’effort portera sur les diplômés qui ont commencé tard à travailler mais qui bénéficient de conditions de travail moins difficiles. Machiavel a encore des lecteurs…
La loi instaure ainsi la « retraite pour pénibilité ». Mais les décrets sont difficiles à mettre en œuvre. Ils nécessitent la tenue de registres notant, salarié par salarié, les expositions réelles aux différents contextes (bruit, chaleur, port de charges lourdes, etc.). L’usine à gaz a de beaux jours devant elle… Il faudra attendre 2017, que le nouveau gouvernement Macron simplifie les critères, sans que cela soulève trop de vagues… tant il y eu de soulagement dans l’air.
Le concept de pénibilité restera cependant acquis malgré ces difficultés opérationnelles. Dans la complexité, la France n’a pas de rival. Aucun autre pays n’a pu (ou voulu…) mettre en place un système analogue.
2019 : l’avortement du régime unique
Les quarante-deux régimes de retraite résultent de la construction historique de la protection sociale. Les retraites se sont d’abord développées par corporations. Depuis la libération, la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) en assure le régime principal : elle gère les retraites des salariés du privé. Les indépendants n’ont pas voulu la rejoindre et chaque profession a ses propres cotisations et calculs de pension. Les employés des transports SNCF ont leurs régimes spéciaux. Les fonctionnaires dépendent du service des pensions de l’Etat. Chaque régime a ses propres règles de calcul. Cette fragmentation a de moins en moins de sens avec le rapprochement des statuts et la mobilité professionnelle entre secteurs. Le projet présidentiel de 2017 prévoit la fusion des régimes en un régime unique à point. Cette idée n’était pas récente, portée depuis plusieurs années par la CFDT.
Son principe est qu’un euro cotisé assure le même revenu à la retraite quel que soit le secteur professionnel. Rien de plus égalitaire ! Jean-Paul Delevoye, ancien ministre et ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) est nommé Commissaire aux retraites en charge de la réforme. Il commence ses consultations dès septembre 2017. La convergence des régimes n’est pas simple techniquement, d’autant qu’elle vise à préserver les droits acquis dans les anciens régimes. Elle est d’autant difficile à présenter qu’il n’y a pas de règle explicite.
Assurer l’égalité entre les différents régimes est un exercice délicat. Pour ne faire aucun perdant, il faudrait augmenter les retraites de tous, ce qui est financièrement impossible dans un système déjà en déséquilibre : la réforme fera des gagnants et des perdants. On n’entendra pas les gagnants, mais les perdants manifesteront leur mécontentement. Les gagnants se tairaient, parce qu’ils… gagnent ? Pas si simple. La complexité des nouvelles règles de calcul est telle que l’assuré ne peut savoir s’il sera perdant ou gagnant. Il ignore quelle sera l’effet de la réforme sur sa propre situation.
Cette incertitude aura joué dans les oppositions à la réforme. La sagesse populaire l’affirme : « on sait ce qu’on perd, on ne sait pas ce qu’on gagne ». Pas totalement faux. Mais pas totalement vrai non plus, car il y a… les exceptions des assurés des régimes spéciaux, SNCF, RATP, danseurs de l’opéra… eux n’ignorent pas leurs avantages : tant ce sont ceux qui ont le plus à perdre. Ils formeront l’avant garde des opposants. Les employés des transports publics ont un moyen de pression sans faille : la grève.
Elle commence le 5 décembre 2019 à la SNCF et durera six semaines. Elle dépasse par sa durée les précédents de 1986 et 1995. La grève s’étend d’abord à la SNCF puis à la RATP, puis à l’Éducation nationale, et le mouvement persiste, en s’étirant, jusqu’à la fin janvier 2020.
Contrairement aux précédents mouvements, le soutien de l’opinion publique s’étiole avec la durée du conflit et tombe de 65 % le 5 décembre à 47 % le 15 janvier. Néanmoins, les manifestations sont très médiatisées du fait de la violence de chaque côté, comme cela avait été le cas un an en plus tôt avec les Gilets jaunes, même si le soutien populaire par le nombre de manifestants est deux fois moindre que durant les réformes de 2003 et 2010, atteignant 800 000 personnes dans les rues, loin des 2 millions sept ans plus tôt.
Chiffres volatils et débat utile
Cette réforme sera abandonnée avec la crise d’épidémie de la Covid-19 mais reste un caillou dans la chaussure du gouvernements actuel. Si les précédents exécutifs n’ont pas cédé à la rue, ils utilisèrent l’article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte au Parlement ; l’opinion retiendra que le mouvement de contestation aura gagné puisque la réforme fut ajournée. Le thème du recul de l’âge de la retraite est devenu éminemment politique. Ainsi, les candidats des partis extrêmes des élections de 2022, ont proposé un retour à la retraite à 60 ans. Si le mode d’ordre serait impensable dans tout autre pays, une majorité de Français n’ignore pas les conséquences économiques du « papy-boom », beaucoup s’accrochent aux règles sociales du passé et se battent dos au mur pour que « rien ne change » dans un monde pourtant en évolution constante.
La difficulté spécifique du thème des retraites est qu’il souffre d’invisibilité chronique tant sur ses réalités chiffrées et émotionnelles que sur ses conséquences financières et sociales, et alternatives possibles. La dégradation de l’hôpital et de l’école, la hausse du pétrole se constatent dans la vie quotidienne. Tout à l’inverse, le financement des retraites est un sujet d’experts : démographes, statisticiens et économistes. Ils manient des chiffres, des milliards d’euros qui ne parlent pas plus au grand public que si c’étaient des millions. En état de cause, les ordres de grandeurs restent en dehors du champ d’appréhension du citoyen lambda. Le domaine semble réservé aux seuls spécialistes du chiffre ou, à l’autre extrémité du débat, aux démagogues et populistes de tous horizons.
Il y a un accord implicite entre les syndicats et le gouvernement pour minimiser le problème : les uns souhaitent éviter tout recul des droits, les autres atténuer des réformes jugées impopulaires et donc… dangereuses politiquement. D’autant que les chiffres en la matière sont très volatils. Le COR chargé des prévisions officielles publie régulièrement des rapports aux conclusions démenties par le rapport suivant. Si les prévisions démographiques paraissent robustes par nature, les hypothèses économiques peuvent changer selon l’évolution de la conjoncture. Si celles-ci se redressent, comme ce fut le cas en 2021, les prévisions s’améliorent et justifient l’inaction et le report, une fois encore, de la réforme.
La responsabilité de tout gouvernement est d’expliquer comment ces chiffres, et surtout l’absence de réelle réforme, mettent en danger le système de la sécurité sociale auquel les Français sont viscéralement attachés. Certes et heureusement, tout chiffre peut et doit prêter à discussion. Les prévisions s’appuient sur des hypothèses de chômage et croissance pour les vingt prochaines années : ces hypothèses présentent autant de certitudes qu’une météo à trois mois.
Pourtant cette incertitude, dont la perception s’accroît à chaque nouvelle révision des chiffres du COR, permet toutes les contestations. Ainsi en janvier 2020, alors que le projet d’âge pivot est critiquée, la CFDT demande un report pour disposer de nouvelles projections, alors que les dernières datent de moins d’un an. Ce report sera fatal. La centrale du premier syndicat du privé, pourtant demandeur de la fusion dans un régime à points, a repoussé l’examen final de la loi déjà adoptée à l’Assemblée national. Par malchance, la crise du Covid a stoppé le processus qui aurait abouti sans ce retard.
Les congrès de médecins font des « conférences de consensus » où les divers points de vue sont confrontés jusqu’à une synthèse partagée. Ce n’est pas le cas dans le domaine économique ou social, tout chiffre est sujet à d’éternelles polémiques : « faites venir vos experts, je ferai venir les miens ! » Ce n’est pas de la gouvernance, c’est un déni de responsabilité.
La cacophonie nuit au débat démocratique. Le vrai sujet des retraites est de choisir quel levier ou quelle combinaison utiliser parmi les quatre seuls possibles : âge minimal de départ, durée des cotisations, niveau des pensions ou taux de cotisations. Il n’y en a pas d’autre. C’est le débat utile. Le Sisyphe français poussera son boulet encore longtemps.
François JEGER, Olivier PERALDI
Co-fondateurs de l’Institut Chiffres & Citoyenneté
[1] Pacte de Tolède 1995.
[2] Réforme Schröder 2003.
[3] 22 septembre 2022.
[4] Le rapport entre la première retraite et le dernier salaire est de 85 % pour les bas salaires et de 60 % pour les cadres.
[5] Le ministère du Travail comptabilisera six millions de jours de grève dont quatre dans le secteur public.
[6] A hauteur de 2 milliards d’euros par an.
[7] Polytechnicien et énarque, aujourd’hui patron d’un grand groupe financier.